Encore la bande dessinée ? Ce n’est pas fini, cette histoire ? On veut bien croire qu’il y a eu, récemment – enfin, il y a environ un demi-siècle – une explosion salutaire, suivie par quelques tentatives, de restauration tout d’abord, puis surtout de récupération, qui auront à leur tour provoqué quelques crises où se seront affirmées une, deux, et même trois générations d’auteurs et d’autrices que l’on aurait pu croire à première vue sans attaches, même si, pour une part non négligeable d’entre elles et d’entre eux, plus que respectueux des grandes figures de l’histoire du genre, ou disons du champ (de ruines) où se dressent encore fièrement quelques pierres à l’effigie de héros increvables, à peine érodées par le vent souvent mauvais de l’air du temps.
Et aujourd’hui… ça continue ? Avec la même force ? On peut s’interroger, mais n’attendez pas de réponse. La bande dessinée, dans ses manifestations les plus intempestives, marginales, individuelles ou collectives, les plus vivantes, contradictoires, enfantines, les plus lucides, exploratoires, inépuisablement mélancoliques, aura autant contribué à décrasser le regard et la pensée que la littérature et les arts plastiques, en relançant, parfois ingénument, les dés de ce qu’on entend par “création”. Pourquoi en aurait-on fini ? Certes, le temps présent semble souvent sans élan ; et le domaine – entre no man’s land et pré carré – paraît moins hanté. Et même si ça piétine un peu ; même si de nombreux projets à peine lancés se brisent sur les murs de plus en plus épais que bâtissent les éditeurs frileux ; même si beaucoup font du sur-place, dans l’espoir de maintenir leur présence dans les bacs ; il y aura toujours quelques fulgurances, quelques pluies d’éclairs sur la réserve, quelques reprises de chantier, quelques prospections inédites nous apportant au bout du compte suffisamment d’ouvrages pour que dossier soit encore loin d’être refermé. C’est pourquoi la chronique reprend son cours : so may we start ?
1.
Du Bruit dans le ciel est un “roman graphique” de David Prudhomme publié chez Futuropolis. Présenté comme se positionnant “aux marges de l’autobiographie et du récit social” – manière de l’intégrer à un courant qui, ces derniers temps, a pris une certaine ampleur –, il parle de mémoire (et) d’oubli – d’anamnèse –, tout en opérant une sorte de reportage au présent, où l’appétit de récit n’altère en rien le plaisir du dessin que l’on sent concrètement à chaque page, même si, çà et là, le trait et le découpage en cases et en séquences peuvent pâtir de l’urgence narrative, frustrant ainsi le lecteur trop rêveur qui aimerait toucher davantage la terre, l’air, avec les yeux : plonger dans l’image comme dans un pays fertile où la pensée parviendrait à nos sens sans passer par les mots. Deux choses me frappent à première lecture : 1. Les cases sont séparées par un “blanc” assez large, ce qui nous permet de plus facilement les détacher, les isoler, les regarder pour elles-mêmes. 2. Le “sens des contours”, avec très peu de lignes non fermées, ce qui fait que le jeu avec les gris (et parfois avec les couleurs) est assez particulier, comme procédant d’une dialectique entre remplissage d’un côté et de l’autre côté recherche d’autonomie graphique. Ce qui rend assez singulière la case, p.82, où le jeune Prudhomme efface un de ses dessins, la surface de blanc produite par le passage de la gomme étant une des seules de l’album à ne présenter aucun contour : pure réserve dans la surface sans bord défini. Ou le fait que tous les ciels, de jour, sont des aplats de jaune, le plus souvent sans nuage (avec quand même quelques exceptions – rien n’est systématique chez David Prudhomme et on l’en remercie), ce qui rend d’autant plus intéressantes les rares scènes de nuit, notamment les six ou sept cases muettes que l’on y découvre, dans lesquelles il y a fort plaisir à plonger. On nous dit que “Prudhomme avait ce livre en lui depuis longtemps” et que “plus encore que l’histoire d’une transmission ou d’héritage, c’est celle d’une mue et d’une personnalité artistique qui se révèle”, ce qui sonne assez juste. Le lieu d’enfance revisité – là où “l’auteur de L’Oisiveraie ou de Rébétiko [a grandi et] s’est construit pour devenir l’un des artistes les plus charmants et incontournables de la bande dessinée contemporaine” – est situé à sept minutes en voiture de la ville de Châteauroux, tout près de la base militaire qui abritait l’US Army. Un lieu comme sans contours, sinon celui des champs environnants : cette platitude limitée çà et là par des rideaux de peupliers qui permettent aux futurs propriétaires de définir des parcelles, les transformant en terrains à bâtir. Mais si, dans ce western à la française avec chevaux et divers animaux domestiques, l’homme gagne du terrain aux dépends de la nature, sauvage ou cultivée, ce qui frappe, ce qui “change l’horizon”, c’est ce fameux “bruit dans le ciel” qui témoigne fortement de la persistance de la guerre à l’autre bout du monde : ce lointain proche qui rompt aussi bruyamment que ponctuellement l’apparente tranquillité de l’“ici”. C’est un grand mérite que d’avoir repris en titre cet irreprésentable, pourtant au cœur du sujet. Cette bande dessinée, bien plus étrange qu’elle n’en a l’air, devrait hanter durablement ses lecteurs – du moins ceux qui prendront distance avec ce qui nous serait raconté dans le ton d’une “petite musique naturaliste” pour suivre les chemins de traverse du trait qui demandent de gratter mentalement au cutter de trop sages contours afin de faire remonter la puissance de l’image : pour en libérer cette substance non bornée qui irrigue la vie secrète des souvenirs.
Alice Guy est la nouvelle bande dessinée de Catel (pour le dessin) & José-Louis Bocquet (pour l’écriture : scénario, dialogues, ainsi qu’un important dossier documentaire – 70 pages environ – en fin de volume), la quatrième chez Casterman dans la collection “Les clandestines de l’histoire”. Ayant récemment révisé, grâce à Jérôme Prieur, le passionnant dossier du “cinéma avant le cinéma” (Lanterne magique), cette biographie dessinée d’une des pionnières du cinématographe tombe à point. Née en 1873, Alice Guy a 22 ans au moment de la première projection publique des frères Lumière, le 28 décembre 1995. Engagée l’année précédente comme sténodactylographe par Léon Gaumont, elle fait, dès septembre 1896, grâce à ce dernier, ses premiers pas de réalisatrice, “en dehors de ses heures de bureau”. Si elle reconnaît que les frères Lumière l’ont précédée (de peu) avec L’Arroseur arrosé, Alice Guy se sait être la première cinéaste de fiction de l’histoire : la première réalisatrice de “saynètes animées”. C’est précisément ce à quoi s’attache cette bande dessinée : animer, selon ses propres règles, de case à case, d’épisode en épisode, une vie encore trop méconnue. Car, bien qu’ayant été une véritable pionnière, son œuvre, à la fois modeste et considérable, a failli disparaître, ou – ce qui est peut-être pire – être attribuée à d’autres. On y croisera des personnages fameux du temps du muet dont beaucoup de lecteurs auront, avant même d’en commencer la lecture, les principaux noms sur les lèvres. Pour ma part, même si l’ombre de Méliès ne peut me laisser indifférent, c’est le lien entre Alice Guy et Louis Feuillade qui m’a le plus intrigué. Tous deux étaient nés la même année et c’est une fois passé la trentaine qu’ils sont entrés en contact en 1905. Feuillade, engagé comme scénariste, tient ses promesses et Alice Guy mettra en scène plus d’un de ses scénarios avant de l’inciter à passer lui-même à la réalisation. Quand, après avoir initié une forme de cinéma parlant, ou chantant, après “avoir mis en boîte une cinquantaine de phonoscènes”, elle se mariera, quittant la France pour s’établir aux États-Unis, elle proposera Feuillade à Gaumont comme “remplaçant”. On connaît la suite. Il est intéressant de noter que c’est au cours de ses recherches en vue de l’écriture d’une biographie de Feuillade que Francis Lacassin a rencontré Alice Guy en 1963 alors qu’elle a atteignait les 90 ans. Recueillant sa parole, il est sidéré par ce qu’elle a accompli qui était alors bien oublié. José-Louis Bocquet écrit qu’il en fera aussitôt “l’héroïne de sa vie”, n’ayant de cesse de lui redonner sa juste place dans l’histoire du cinématographe, établissant sa filmographie, et publiant ses “souvenirs de pionnière”. Sa fameuse Contre histoire du cinéma publiée chez 10/18 s’ouvre par un chapitre intitulé “Alice Guy, la première femme réalisatrice du monde”. Bocquet nous confie en fin de parcours que c’est Francis Lacassin qui lui a passé le flambeau, lui confiant ses archives afin qu’il “poursuive son combat de réhabilitation” – non en accomplissant un travail d’historien, mais en pratiquant son métier de raconteur d’histoires en bande dessinée –, ce dont il s’est chargé avec cet épais volume des “Clandestines de l’histoire” construit en grande connivence avec la dessinatrice, Catel. Parmi les nombreux livres qui prétendent aujourd’hui nous transmettre avec fluidité un peu de savoir, Alice Guy a le mérite d’apporter quelque chose de bien plus rare que le sérieux, à savoir la fantaisie – le trait de la dessinatrice s’accordant mieux à la gaité, à ce qui dynamise la vie, y compris dans les moments difficiles, qu’à la mélancolie (même si cette histoire est au fond terriblement mélancolique, mais c’est une autre affaire).
Des Vivants est une bande dessinée écrite par Raphaël Meltz et Louise Moaty, dessinée et mise en couleurs par Simon Roussin et publiée aux éditions 2024. Encore un ouvrage “hors normes” : de grand format sur 260 pages, dont 21 de notes très serrées sur trois colonnes, somptueusement relié, cartonné, toilé, ce qui fait honneur aux éditions strasbourgeoises qui sont loin d’en être à leur premier essai. Avant de parler de ce qui saute aux yeux, disons quelques mots du projet. Commençons par son sujet : “1940-1942, le réseau du Musée de l’Homme est un des tout premiers réseaux de résistance à l’occupant nazi.” L’histoire en est plus ou moins connue ; on y croise certaines personnalités fameuses comme Paul Rivet, Boris Vildé, Jean Cassou, Claude Aveline, Germaine Tillion ; pourtant “après guerre, Boris Vildé et ses camarades n’ont pas reçu la reconnaissance qu’ils méritaient, et l’ensemble du groupe du Musée de l’Homme est parfois oublié dans les histoires de la résistance.” Si certains d’entre eux sont morts, fusillés ou déportés, avant la libération, ils resteront toujours des vivants – d’où le titre de cet album qui fait de l’ethnologue Boris Vildé une “sorte de Jean Moulin avec deux ans d’avance” et se fait fort, dès la première page, d’annoncer la couleur : “Les événements relatés dans ce livre s’approchent au plus près de la réalité historique. Tous les personnages ont véritablement existé. Tous les mots qu’ils prononcent sont les leurs : paroles trouvées dans leurs lettres, journaux, témoignages, entretiens, souvenirs. Des traces, des fragments de leurs mémoires, montés et adaptés pour composer un récit.” Et, juste après la dernière image : “nous avons répété ce que nous avons entendu. L’histoire est finie.” Ce dont les éditeurs sont particulièrement fiers : cette mise en parenthèses de la fiction au profit du réel – non trafiqué ! –, ce qui peut sembler un comble “pour une maison d’édition qui s’est jusqu’ici construite dans le refus de la bande dessinée du réel […] Un virage majeur !” Oui, mais…
Deux choses : 1. Le montage, c’est l’essentiel. Monter, agencer, faire des collants, même virtuels, c’est créer véritablement, tout en s’offrant le luxe de s’effacer : de disparaître avec classe. Et c’est peut-être ce qui fait le prix de cette mise à plat de ce “pan d’Histoire” : de sa transformation, très pertinente, en bande dessinée. 2. Du coup le dessin prend une importance considérable ; il n’est jamais assujetti, même s’il respecte son sujet, ne le dénaturant jamais. Il résiste à sa manière. Il se permet tout, que ce soit du côté du trait ou de la couleur ; il est plus que jamais signé par son auteur, Simon Roussin – Des Vivants trouvant naturellement sa place à côté de ses précédents livres, et particulièrement ceux publiés chez 2024 : Lemon Jefferson, Heartbreak Valley, Prisonnier des glaces et Xibalpa. Il y a quelque chose d’à la fois radical et léger dans ce travail qui peut parfois sembler insouciant, tout en manifestant nombre d’exigences graphiques, trouvant de belles propositions en réponse à ce qu’il aura interrogé. Par exemple : “Le dessin accompagne ces voix [de celles et ceux que l’on nomme ici : des vivants], les fait revivre le temps du livre, mais ne doit pas sur-interpréter. Ça, c’était vraiment l’enjeu principal – Simon Roussin)”. N’ayez aucune inquiétude, on ne résumera pas en trois phrases cette histoire ; si vous êtes intigués par ce qui vient d’être dit, il vous faudra vous procurer le livre. Et si le silence vous attire, vous pourrez aussi apprécier les dessins, illustrations, affiches et planches de Roussin accrochés sur les murs de la galerie Arts Factory, 27 rue de Charonne à Paris (du 5 octobre au 20 novembre).
2.
L’approche sociologique, historique, etc. – le réel qui fait irruption dans le champ où, de Little Nemo à Krazy Kat, de Major Fatal au Concombre Masqué, des Alpages au Mont-Vérité, n’ont cessé de surgir des inventeurs de mondes, des bâtisseurs d’espace-temps narratifs et graphiques – parfois on en a plus qu’assez. On demande alors de faire silence pour écouter les bruissements, les murmures – mais aussi le fracas assourdissant – qui donnent à certaines planches pourtant traitées en surface un très curieux relief. C’est toujours un plaisir de découvrir des bandes dessinées muettes dont il est problématique de rendre compte, car comment répondre au silence autrement que par le silence, sinon en creusant au plus loin l’exégèse du dessin, s’attachant au plus minuscule détail. Le dessin ? Ce qu’on ne peut résumer, à la manière dont certains le font (à tort) d’un récit.
Le Sel et le ciel est un petit livre de Marc-Antoine Mathieu imprimé en deux tons, noir et Pantone gris – son premier livre à L’Association qui ne soit pas dans la collection “Patte de Mouche”. Fait d’une suite de 36 dessins de même format (à l’italienne, un par page), précédée par un court texte introductif, découpé en trois parties – “Il sera une fois une mer asséchée… / …dont il ne restera que le sel… / un sel qui aura brûlé tous les regards…” –, ce récit a été pensé “dans le cadre d’une carte blanche donnée à l’auteur pour créer une déambulation à travers le parc Fosse-aux-Ours de Lyon.” Tous les projets de Marc-Antoine Mathieu ont le pouvoir de se déployer aussi bien dans l’espace du livre que dans d’immenses volumes, hangars, salles d’expositions, ouverts ou fermés. Pour donner une idée de cette adaptation livresque d’une déambulation, relevons un goût de l’épure qui n’interdit pas au dessinateur de céder à la tentation du dessin fouillé sur lequel on peut s’arrêter longuement, même si la représentation du mouvement reste privilégiée. Et que le sable – d’un désert du bout du monde comme toujours – recouvre cette fois l’épave d’un immense navire. Quelques humains schématisés à l’extrême, le regard éteint (comme brûlé ?), désenfouissent cette épave qui, une fois le travail achevé, s’élève, prenant le chemin du ciel, tandis que ceux qui accompli ce travail recouvrent, sous l’effet de la sidération, la vue – mais pour voir quoi, sinon une disparition ? On nous précise qu’il s’agit “d’une fable onirique sur la condition humaine”. Pourquoi pas ? Mais à titre personnel, je préfère n’en rien savoir – et même n’y rien comprendre. Aucune envie d’être pris par la main. Quel plaisir de ne pas relire deux fois la même histoire : de ne pas se baigner deux fois dans le même fleuve. Aussi le lecteur referme-t-il Le Sel et le ciel – livre qui requiert d’avoir de l’oreille – sans un bruit.
20 KM/H est un ouvrage de Woshibai, auteur de 32 ans vivant à Shanghai, publié par L’Employé du moi. Il fait dans les 320 pages à raison d’un ou (le plus souvent) deux dessins par page, en noir et blanc, à l’exception d’une brève séquence montrant un arc-en-ciel en quadrichromie. Bande dessinée muette, de nouveau, n’était un certain nombre d’idéogrammes en ouverture de séquences – leur titre, probablement. 20 KM/H est une bande dessinée relativement expérimentale, je veux dire qui ne ressemble à rien de convenu, même si procédant souvent par paraboles, usant d’un langage graphique plutôt épuré, flirtant comme Le Sel et le ciel avec l’onirisme et bruissant de mille sons. Suite d’énigmes – à résoudre, ou non –, plutôt que recherche d’abstraction. Le titre de cet ouvrage reprend celui d’une séquence où l’on voit une carriole tirée, non par des chevaux, mais par des papillons traverser un paysage plutôt vide ; sensation étonnante de vitesse – mais peut-on lire cette histoire avec un regard à 20 KM/H ? Singulière découverte que ce dessinateur de la Chine d’aujourd’hui, porteur d’un humour plutôt décapant, comme dans cette séquence intitulée Fiction où un “écrivain” frappe à la machine un texte illisible sur un ruban sans fin, aussitôt retaillé en fines bandelettes de papier : où le plaisir graphique, le goût de la ligne, de la composition, semble primer sur le récit qui pourtant circule, se déploie en surface en tous sens.
Totale Résistance est un livre d’Helge Reumann publié par Atrabile qui a déjà à son catalogue plusieurs ouvrages du même auteur, dont l’incontournable Black Medicine Book en 2017, et SUV en 2019. Composé d’une suite de short stories, muettes comme il se doit, publiées entre 2000 et 2021 dans divers supports dont Strapazin et Drozophile, Totale Résistance remet en jeu certaines caractéristiques du travail de Reumann, reconnaissable au premier regard et en perpétuelle métamorphose : d’une totale autonomie, d’une inactualité souveraine (d’où sa force de résistance), d’une rigueur implacable. Les planches – en noir et blanc comme en couleurs – sont imprimées, selon les cahiers, sur divers fonds colorés. Totale Résistance, qui baigne en permanence dans cette étrange clarté qui illumine la scène de nos rêves, est un des plus beaux livres de cette rentrée. Et comme toujours, l’absence de mots nous conduit, non à accélérer le tempo de lecture, mais au contraire à le ralentir afin de prendre le temps de s’attarder sur le moindre détail – la moindre idée graphique. La puissance de ces histoires brèves d’Helge Reumann, comme de son travail en général, vient de la grande cohérence de qui est décliné obsessionnellement de case en case, d’image en image ; et aussi du fait que cet univers singulier, “non interchangeable”, n’impose aucune directive quant à son interprétation. On gagne sur tous les fronts, notamment ceux – intimement solidaires – de la recherche d’authenticité et de la quête de liberté. Si le lecteur peut s’y trouver captif, c’est uniquement parce qu’il l’aura désiré. Mais ce qui lui est accordé en retour comme monnaie d’échange, c’est un des biens les plus précieux qui soient : le temps physiquement, émotionnellement, retrouvé.
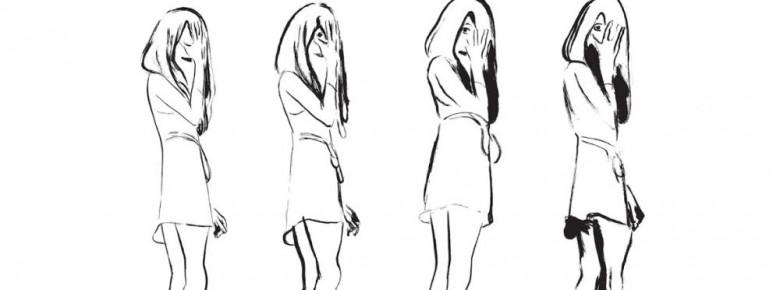
3.
Il est encore trop tôt pour parler de Dédales de Charles Burns dont le deuxième épisode vient de paraître chez Cornélius. S’il convient de se précipiter les yeux fermés en librairie, d’autant plus que ça fait bien deux ans que nous l’attendons – le premier épisode étant sorti à l’automne 2019 ; et nul ne sait quand paraîtra le troisième (et probablement dernier, vu que Burns apprécie les constructions en trilogie) –, nous ne sommes pas encore prêts à le commenter, ce suspense nous rendant quasiment aphasique, étant simultanément comblés et travaillés par une nouvelle attente, celle d’une suite dont nous ne savons rien, même si certains seront persuadés de pouvoir en pressentir l’essentiel (étrange leurre). Bien sûr, histoire de rompre le silence, il est possible de tenter une brève exégèse de la lente métamorphose de son trait, sculpté avec franchise, non dénué de délicatesse, typique d’une certaine bande dessinée américaine qui se défie en apparence des écoles d’art, tout en leur empruntant au passage certaines manières de faire, parfois académiques, dont il est certain qu’elles séduisent un assez vaste public respectueux des codes de la bande dessinée ; un trait paradoxalement inventif dans le refus de s’aventurer dans le pur graphisme, touchant par sa défiance envers la sensualité, et très curieusement souple via l’usage moins figé qu’il n’y paraît d’une certaine raideur – l’essentiel étant comment la fiction, bien servie par le noir et blanc du dessin, et la mise en couleurs, chemine. Le titre n’est pas Dédale (au singulier), mais bien Dédales (au pluriel). Nous y reviendrons au moment où le point final sera apposé.
La Part merveilleuse 1. Les mains d’Orsay, est une bande dessinée de Ruppert & Mulot publiée chez Dargaud. Nous ignorons combien de volumes sont (ou non) prévus, mais cette fois nous n’attendrons pas pour dégager rapidement quelques impressions à première lecture. Souvenons-nous : Florent Ruppert et Jérôme Mulot en ont impressionné plus d’un au moment de la publication de leur premier livre, Safari Monseigneur à L’Association en 2005. Pas loin d’une vingtaine d’opus ont suivi, divers tant par la forme que par le contenu – duplus faussement classique (jouant avec les clichés du genre) au plus radicalement ouvert (à d’autres domaines, de la danse à l’installation) – confirmant une présence : celle d’un duo dont on ne saura jamais exactement qui a fait quoi, mais peu importe, car, à l’arrivée, l’œuvre est singulière ; un duo qui travaille parfois en collaboration, passant de deux à trois fois deux mains, et même ponctuellement à toute une bande (La Maison close). Leur ouvrage publié chez un éditeur mainstream le plus convaincant jusqu’à aujourd’hui était le jouissif Portrait d’un buveur, écrit et dessiné en collaboration avec Olivier Schrauwen (Aire Libre Dupuis, 2019). La Part merveilleuse, dont nous sont révélées les 150 premières pages, est, sinon du même tabac, disons un compromis réussi qui devrait récolter, du moins espérons-le, un certain succès.
Partons du titre qui en évoquera pour certains deux ou trois autres présentant le même commencement : La part du feu / La part maudite. Puis du sous-titre du premier tome, Les mains d’Orsay, qui renvoie à un autre tout aussi fameux, celui du récit fantastique de Maurice Renard, Les mains d’Orlac (1920), plusieurs fois adapté au cinéma, notamment par Karl Freund en 1935 avec Peter Lorre. Orsay nous fait aussi songer au musée du même nom situé dans l’ancienne gare qui menait à Orsay où le XIXesiècle, celui du merveilleux contre le mystère (André Breton), est à l’honneur. Mais peut-être sont-ce de fausses pistes, même si elles évoquent judicieusement un passé encore proche, ainsi que certaines formes de littérature populaire. La Part merveilleuse n’est pas exactement, comme on nous le suggère, une “excursion inattendue” de notre duo dans la science-fiction (ou le fantastique, genre moins circonscrit). C’est la poursuite d’un travail où il s’agit en premier lieu de traiter des corps, de leurs mutations : motif récurrent de l’art contemporain – toutes formes et techniques confondues. S’ils s’engagent dans un récit où s’opèrent des rencontres entre humains et une forme d’altérité radicale, Ruppert & Mulot conduisent leur affaire de manière, comme toujours, assez “tordue”, traitant par surprise de la beauté ou de la douceur – sujets difficiles en bande dessinée, si l’on désire échapper au sentimentalisme, ou dépasser les limites de l’humanisme standard. Ce qui est remarquable dans cette histoire qui semble revisiter de manière rêvée notre quotidienneté, c’est l’invention des Toutes : ces fameux autres qui ne ressemblent à rien de ce qu’on connaît – ni aliens d’aspect plus ou moins humanoïdes, ni spectres –, qui naissent de la force de l’image et au sujet desquels on doit passer par notre propre imagination pour se les figurer sensuellement : les toucher, les sentir, leur apporter quelques contours, pensées et sentiments, à la fois indéfinissables et profondément concrets.
Les férus de psychanalyse – les lacaniens en premier lieu – seront ravis du choix de ce nom, et s’en amuseront. “Les Toutes”, nous dit Florent Ruppert, “sont des êtres doux, calmes, pacifiques, ils sont très beaux, et on ne peut pas vraiment faire grand-chose avec. Les Toutes, ce sont des êtres qu’on doit représenter, ils ont une présence, mais ce sont aussi des contenants. Quand un personnage touche un Toute, il est projeté dans un univers parallèle, c’est comme s’il entrait dans l’âme du Toute […] Ils ne marchent pas avec la même énergie que nous, ils n’ont pas de bouche, ils peuvent toucher le sol, mais aussi flotter. Du coup, on peut aller vers une sorte d’abstraction. En fait, ce qui nous intéresse avec ces Toutes, c’est de créer quelque chose qui est […] de l’ordre de la beauté.” Et Jérôme Mulot : “Le fantastique est métaphore du sensoriel. Toute cette part un peu déformée, plastique, n’est qu’un prolongement graphique de choses ancrées dans l’inconscient, les émotions, l’intériorité des personnages que la bande dessinée permet de transcrire visuellement.” Une fois encore, on ne racontera pas l’histoire, on se contentera de noter un décalage permanent entre les divers niveaux d’interprétation du récit qui l’empêche de devenir lourdement démonstratif, ou naïvement édifiant ; il faut prendre ce qui arrive comme on le fait dans nos rêves qui parfois nous enchantent et parfois nous terrifient. C’est un cauchemar très doux ; ou, au contraire, un voyage à la fois merveilleux et dangereux dans le plus violent de l’entreprise humaine où les corps luttent pour demeurer, non seulement en vie, mais renaissants à l’envi – le problème n’étant pas de refuser toute forme de mutation, mais d’orienter le pouvoir de métamorphose qui nous est attribué dans le sens d’obtenir un surcroît de vie, manifestant un rapport juste au concept de survie. Continuer, c’est aussi explorer des continents perdus – la beauté en est un – et ainsi maintenir, voire élever, le niveau de désir au plus haut. Bref : laisser grandes ouvertes les vannes de l’imagination, et ne pas brider la main qui dessine. Et surtout se garder de délivrer quelque message que ce soit. On se réjouit par avance de découvrir ce qui adviendra dans le/les prochain(s) tome(s) dont nous avons la chance, bien plus rare qu’on ne le croit, de n’encore rien savoir.
Maintenant une curieuse histoire : celle qui m’a conduit à m’offrir un des plus beaux portraits de ville jamais dessiné : Brussels, d’Ever Meulen, publié par Louis Vuitton dans le cadre de ses “Travel Books”. Si j’avoue me méfier de ce qu’entreprennent les marchands de luxe, dans le cadre ou non du mécénat culturel, je dois reconnaître que, quand un grand artiste répond à leur commande, le résultat est somptueux et, de plus, vendu à un prix acceptable (celui d’un livre d’art lambda, un catalogue d’exposition par exemple).
Brussels, sorti peu avant l’été, est très vite devenu introuvable. Étant depuis longtemps à l’affut de ce que peut produire Ever Meulen, j’en avais entendu parler. Je n’attends guère en principe pour acquérir un nouvel ouvrage de l’auteur de Feu vert, de Verve, ou encore d’Automotiv. Je me suis donc rendu dans plusieurs très bonnes librairies, mais je m’entendais dire à chaque fois que ce “Travel Book” était en rupture de stock. J’avais fini par en faire mon deuil, attendant une hypothétique occasion sur eBay ou ailleurs. Et puis, un beau jour de ce début d’automne, je me suis souvenu qu’il y avait une boutique Vuitton là où se trouvait jadis “La Hune”, du côté de Saint-Germain-des-Prés. J’y suis donc allé, afin de tenter une dernière chance. Rien de moins naturel pour moi que de pénétrer ce genre de magasin où l’on est très bien accueilli, mais où on se sent aussitôt comme un animal sauvage débarqué sur une planète lointaine où tout est incompréhensible. Dans ces magasins de luxe, les objets hors de prix semblent intouchables, non parce qu’il nous serait interdit de les toucher, mais parce que l’idée même de les effleurer du regard ne nous viendrait jamais à l’esprit. Une fois franchi le seuil, une aimable vendeuse me demande ce qu’elle peut faire pour moi. Je lui réponds que “je suis à la recherche un “Travel Book” nommé Brussels.”
Ce titre ne lui dit rien, mais elle pense qu’il pourrait se trouver dans les réserves au sous-sol. Elle me demande de patienter, le temps d’entreprendre quelques recherches. Je ne sais comment tuer cette attente (“je ne peux plus tuer personne en prison, sauf le temps” dit Henry McHenry à sa fille Annette, à la toute fin du film de Carax), tentant de dissimuler mon malaise en faisant semblant de chercher à comprendre le lien secret entre ces fameux produits de luxe, sacs et autres, qui m’ont toujours étonné par leur banalité triomphante (pour reprendre une expression d’Igor Stravinsky) et ce livre d’une classe folle. Les minutes passent ; l’espoir s’amenuise. Je suis au bord de prendre la poudre d’escampette quand la jeune vendeuse revient triomphante avec LE livre, que je découvre enfin : encore plus beau qu’espéré. Je propose de régler la facture au plus vite ; mais elle me confie qu’il est offert à tout acquéreur un écrin particulier pour le protéger : une boîte en carton très solide, et d’ailleurs assez jolie, la marque Louis Vuitton étant assez bellement typographiée. Elle me reprend des mains l’ouvrage, me demande encore un peu de patience, avant d’entrer dans un nouvel espace interdit aux visiteurs, pour se mettre en quête une nouvelle fois de “l’objet idéal”, celui pour lequel le “client roi” est prêt à tout. La nuit n’est pas loin de tomber.
Encore quelques minutes qui durent des plombes et, le livre deux fois emballé en main, je retrouve enfin l’air libre. M’engouffrant dans le métro, je n’ose le sortir de sa précieuse boîte, totalement déconcerté par le fait de posséder un produit Vuitton. Mais, cela valait la peine. Comme je l’ai dit : Brussels frise la perfection. Faites-moi confiance, tentez votre chance. Il reste peut-être encore quelques exemplaires dans un de ces magasins que vous et moi n’aurions jamais imaginé un jour pénétrer. Ou une nuit – car ce que je viens de raconter m’est peut-être arrivé en rêve.
4.
Des deux livres que Nadja vient de publier chez Actes Sud BD, Le Fil d’Ariane et Le Jardin d’Ariane, c’est au second – celui qui s’adresse aux enfants – que va ma préférence, peut-être pour des raisons de forme, le texte étant inscrit en caractères d’imprimerie, noirs ou blancs, sur les doubles-pleines-pages peintes, plutôt que dans des bulles, comme c’est le cas pour le premier – celui qui s’adresse aux “grands” (dont en principe je fais partie), mais dont le dispositif formel ne me parle guère, m’empêchant d’apprécier le lien organique établi par l’autrice entre image et récit. Ariane est un “sujet” magnifique, un thème susceptible de provoquer d’innombrables variations. À peine Le Fil d’Ariane ouvert, on découvre quelques vers du célèbre Lamento de Monteverdi. Ayant sous la main plusieurs enregistrements de cet air si puissamment mélancolique, je le réécoute pour la nièmefois. Mais en relisant plutôt Le Jardin d’Ariane – ce petit théâtre peint sur le papier où figurines et poupées inanimées se mettent à vivre, une fois l’enfant endormi. Ici, fable n’étant pas parabole, le sens est plus ouvert : d’une déconcertante simplicité qui, paradoxalement, lui apporte une certaine force. On le sait, les enfants aiment qu’on relise infiniment leurs histoires préférées. Quand ils n’ont pas encore appris à lire, ils écoutent attentivement la lecture qu’on leur fait, laissant librement leur regard vagabonder sur les images. Et c’est alors que divers dialogues s’entrelacent. Le livre est un lieu d’échanges où rien n’est fermé – où tout ce qui a été (et parfois trop) réglé peut être, sinon déréglé, disons : changé, amélioré de manière subjective ; où ne pas tout comprendre est une chance et non un problème.
Le Club des amis de Sophie Guerrive est une très belle série d’albums destinés à la jeunesse publiée aux éditions 2024, dans leur collection “4048”. Un deuxième tome vient de paraître et c’est un enchantement. On y découvre que “tous les oiseaux apprennent la magie dès qu’ils savent voler”, ce qui leur apporte, entre autres choses, “un regard mystérieux”. Ce qui arrive à cette bande d’amis (ours, serpent, oiseau…) suit sa logique propre qui est celle où le jeu avec les mots, avec les idées, les matières, les saisons, etc., doit s’accorder à chaque instant au dessin, à moins que ce ne soit le contraire. L’invention semble si libre, si spontanée, si fraîche – et pourtant très classique, nourrie de lectures anciennes et de souvenirs du temps d’après la naissance. “Où va-t-on maintenant ? Je ne sais pas. On suit le courant.” L’adulte qui tombe sur cette histoire est lui aussi touché, non parce qu’il serait resté un enfant, mais parce qu’au fond, c’est sa manière d’être : non de suivre le courant (au sens d’être à la page), mais de se laisser emporter par ce qui vient, pour le plaisir de s’égarer, de se désorienter, avant de retrouver son chemin en retissant des liens avec ce qui l’environne, en toute amitié, non seulement avec ses semblables, mais aussi avec les autres : le monde extérieur, la nature ici principalement. Et pour cela, on ne compte plus le temps qui passe : infini, comme la mer ou la lecture.
Signalons pour terminer la réédition bienvenue chez Dargaud de deux albums de F’Murrr datant du début des années 1990 : Le Pauvre chevalier et Les Aveugles qui retrouvent enfin leur format d’origine (17 x 27). Prépubliées tout d’abord dans (à suivre), puis en album chez Casterman, ces deux histoires sont aujourd’hui augmentées d’un copieux dossier composé d’études, de croquis, de notes de travail, montrant à quel point F’Murrr était perfectionniste et toujours en recherche. Avec ce diptyque, resté sans suite, l’auteur du Génie des Alpages et de Tim Galère réglait merveilleusement ses comptes avec la littérature médiévale, s’inscrivant ainsi dans une certaine tradition en proposant sa propre version, aussi érudite que libre. Mais, davantage qu’en hypothétique ouverture, Le Pauvre chevalier comme Les Aveugles doivent être plutôt considérés comme manière de boucler la boucle, proposant un étonnant achèvement d’une œuvre qui aura imposé son auteur parmi les plus grands dessinateurs de bande dessinée de son temps. Après 1992, F’Murrr reviendra principalement aux Alpages, distillant au compte-goutte quelques variations supplémentaires. Il continuera aussi de dessiner dans des carnets : Deux Mille Meuf ou on ne sait quel crayonné impromptu. Il y a encore du travail de réédition à accomplir, comme, par exemple, de nouveaux volumes de l’intégrale du Génie des Alpages. Affaire (à suivre).
David Prudhomme, Du Bruit dans le ciel, Futuropolis, août 2021, 208 p., 25 €
Catel & Bocquet, Alice Guy, Casterman, septembre 2021, 400 p., 24 € 95
Raphaël Meltz, Louise Moaty, Simon Roussin, Des Vivants, Éditions 2024, octobre 2021, 260 p., 29 €
Marc-Antoine Mathieu, Le Sel et le ciel, L’Association, septembre 2021, 48 p., 25 €
Woshibai, 20 KM/H, L’Employé du moi, octobre 2021, 320 p., 25 €
Helge Reumann, Totale Résistance, Atrabile, septembre 2021, 128 p., 30 €
Ruppert & Mulot, La Part merveilleuse 1. Les mains d’Orsay, Dargaud, septembre 2021, 156 p., 22 € 50
Ever Meulen, Brussels, Louis Vuitton Travel Book, mai 2021, non paginé, 45 €
Nadja, Le Fil d’Ariane et Le Jardin d’Ariane, Actes Sud BD, septembre 2021, 224 et 32 p., 26 et 15 €
Sophie Guerrive, Le Club des amis 2, Éditions 2024, collection “4048”, septembre 2020, 56 p., 14 €
F’Murrr, Le Pauvre chevalier et Les Aveugles, Dargaud, mai 2021, 96 et 128 p., 22 € 50 et 25 €








