René de Obaldia était, à la lettre, un homme du monde : il était né à Hong Kong d’un père panaméen et d’une mère picarde. Il a composé des pièces pétillantes qui nous enchantent. J’ai rarement autant ri qu’aux tirades de Monsieur Klebs lancées par Michel Bouquet, aux insolences acidulées du Satyre de la Villette, aux reparties foutraques Du vent dans les branches de sassafras. J’ai lu toutes ses pièces avec le plaisir d’y retrouver les saveurs aigres-douces et les tons noir et rose chers à Jean Giraudoux, à Jean Anouilh et Marcel Aymé – l’avant-scène du réalisme magique, dont il avait repris le flambeau.
De l’esprit
Comme pour eux, son art théâtral était un art des mots trempés dans un bain d’esprit. Une prestidigitation de verbe et de cocasseries poétiques qu’on retrouvait dans ses romans. Je dois un de mes derniers enchantements de lecture à son Exobiographie, et de théâtre à son Grasse matinée – une histoire de morts joyeuses, pleine de rebondissements et d’arabesques.
→ PORTRAIT. Mort de René de Obaldia, éternel « ébaubi »
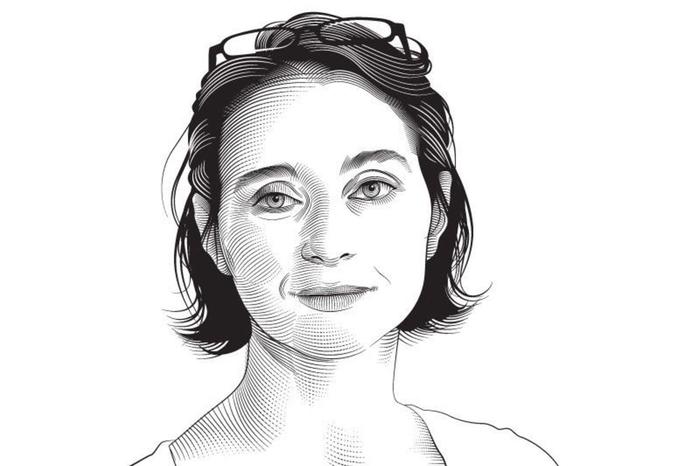
Je me rappelle mon émotion lorsque j’ai fait sa rencontre. Je craignais que l’homme ternisse l’image de l’écrivain. Il est parfois difficile d’apprivoiser la réalité d’un personnage qu’on a fréquenté dans ses livres. D’emblée, j’ai été charmée, conquise. Il y avait quelques années déjà qu’il n’écrivait plus. Cela étant, il continuait de composer. Ses souvenirs, des personnages. Chez lui, il faisait son théâtre. Il citait la phrase de Jean Cocteau : « Sans le diable, jamais Dieu n’aurait atteint le grand public. » Il pastichait ses interprètes. Il excellait à imiter Michel Simon (« Il m’avait dit qu’il donnerait n’importe quoi pour interpréter Du vent dans les branches de sassafras ; il m’a pris fort cher quand il a accepté. »)
Prisonnier
Parfois, il évoquait aussi, de plus en plus souvent peut-être, les années douloureuses de sa détention en Silésie, alors prisonnier lors de la Seconde Guerre mondiale (« Que voulez-vous, les Allemands m’ont tellement aimé qu’ils m’ont gardé quatre ans. ») Je me suis souvent demandé si l’extrême légèreté de son esprit, son essence iconoclaste ne procédait pas du désespoir, de cette « surabondance de gravité » dont il définissait l’humour. Dans ce stalag, où il a « oublié d’avoir et appris à être, uniquement à être », il avait reçu un exemple : celui d’un détenu qu’il n’allait jamais oublier – « Cet homme lisait les lignes de la main aux prisonniers à bout de souffle, et leur présidait un avenir exquis et des surprises merveilleuses. »
→ RELIRE. René de Obaldia, la grâce de l'instant.
On sortait toujours plus léger de ces rencontres, regonflé à l’hélium, enchanté par son esprit, son ton alerte. « Vous savez ce que l’on dit : à l’école, j’étais un cancre. Oui, il est vraiment de bon ton de dire qu’on était un cancre. Et bien, moi, pardonnez-moi, mais je n’étais pas un cancre, j’étais simplement nul ! » On était porté par sa mémoire étincelante, ébahi d’avoir écouté la voix claire et précise d’un homme qui avait connu, avant-guerre, Lou-Andreas Salomé, la muse de Nietzsche ; d’un écrivain qui fut l’ami de Jean Paulhan et d’Eugène Ionesco, et qui, avant-guerre encore, participait au banquet des jeunes admirateurs du poète Saint-Pol-Roux, l’orfèvre du symbolisme.
En rentrant chez moi, je prolongeais le plaisir de l’entretien par une plongée dans la fraîcheur de ses Innocentines, poèmes pour enfants et quelques adultes. Je notaisses reparties vives et désopilantes. Et je souriais toujours de ce qu’il venait de me raconter, sur sa stupéfaction amusée lorsqu’il avait entendu Michel Simon qui « perdait la mémoire et, quand il ne zappait pas des répliques entières, en donnait qui n’étaient pas dans ma pièce » annoncer, le soir de la première, au tomber du rideau et devant un public en délire : « La pièce que j’ai eu l’honneur de donner devant vous pour la première fois… la pièce… l’honneur… Merde, j’ai oublié le nom de l’auteur. »
« J’ai décidé de vivre éternellement. Pour l’instant, tout se passe comme prévu » ! René de Obaldia aurait pu signer cette citation d’Alphonse Allais. Pour ses 100 ans, il avait trouvé sa formule : « J’ai vécu jusqu’à aujourd’hui, je ne vois pas de raison pour que ça ne continue pas. »
Une mort par distraction.
À 103 ans, on a pu croire que la mort l’avait oublié. On s’est alors rappelé qu’il avait très tôt annoncé ses intentions. Encore vert, quoique pas encore académicien, il avait signé l’un de ses romans Le Centenaire. Puis il avait réitéré ses pieds de nez à la Camarde en titrant l’une de ses pièces Le Défunt. Enfin, dans Génousie, il imaginait les multiples manières dont il quitterait cette terre. Par la rate ? Par l’estomac ? Par un caprice du palpitant ? La liste drolatique évoquée n’avait pas envisagé une mort par distraction. C’est pourtant en oubliant de se réveiller de sa sieste, dans son fauteuil égayé d’un châle de couleur vive, qu’il s’est éloigné, sans doute ravi par l’image du paradis dont il avait eu, un jour, l’entrevision. Celle d’une verte prairie piquée de marguerites et de boutons d’or.








